TERMES DE REFERENCE
I. Résumé synthétique de la mission
| Intitulé de la mission | Conduire une analyse des goulots d’étranglement entravant la mise en œuvre efficace de la CSU au Burkina Faso |
| Projet liée à la mission | « CREATION D’UN MOUVEMENT SOCIAL EN FAVEUR DE LA CSU, Burkina Faso » |
| Résultats du projet auxquels contribue la mission | Résultat : « Des évidences sur les différents blocages de la mise en œuvre de la CSU sont identifiées, et pris en compte dans les prochaines politiques et stratégie de santé » |
| Activité du projet définissant la mission | Activité 3.1 : Conduire une analyse des goulots d’étranglement entravant la mise en œuvre efficace de la CSU au Burkina Faso |
| Pays | Burkina Faso |
| Financement | USAID via R4D |
| Période de la mission | Septembre 2020 |
| Durée de la Mission | 15 jours |
II. Contexte et présentation de l’étude
2.1. Problématique
La population du Burkina Faso est estimée à 19 034 397 habitants en 2016. Avec une densité d’environ 51,8 habitants au km², cette population croît à un rythme de 3,1% l’an (Institut national des statistiques et de la démographie, 2006). L’économie est fortement dominée par l’agriculture qui emploie près de 80 % de la population active. En 2014, l’incidence de la pauvreté était estimée à 40,1% et le revenu national brut par habitant à 690,4 dollars. La population est dépendante, c’est-à-dire les moins de 15 ans et les plus de 64 ans, était quant à elle estimée à 49,26 % contre 50,74 % pour la population active.. L’indice synthétique de fécondité (ISF) est de 5,4 pour l’ensemble du pays dont 5,8 en milieu rural contre 3,7 en milieu urbain (INSD [EMC] 2015). La proportion des femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) au sein de la population féminine est de 45,76 % dont la majorité se retrouve en milieu rural. Au sein du groupe vulnérable que constitue le couple mère-enfant, le rapport de mortalité maternelle faisait état de 330 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité infantile était quant à lui de 91,7 décès pour 1000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité infanto-juvénile était de 141,9 pour 1000 naissances vivantes (op.cit, 2015).
Les politiques de protection sociale, héritées du système colonial n’ont pas pu être reformées pour s’adapter aux nouveaux risques sanitaires et sociaux des individus. Le système de protection sociale se compose de plusieurs programmes d’action qui se fondent sur un renforcement de l’Etat-providence.
D’abord, le programme des filets sociaux constitue un ensemble de prestations et de services délivrés à l’endroit des personnes vulnérables ou les ménages pauvres par les services publics ou des organisations non gouvernementales. La mise en œuvre de ce programme consiste entre autres à la vente des produits alimentaires à des prix subventionnés, à la dotation des écoles de cantine scolaire, à la distribution de coupons alimentaires, aux transferts monétaires (Sawadogo 2010).
Ensuite, les mécanismes d’assurance sociale sont un ensemble de dispositifs de protection sociale orientés vers les travailleurs de l’administration publique et privée. La loi 013/98 du 28 Avril 1998 stipule à son article 28 que ” tous les agents de la fonction publique bénéficient d’une protection sociale en matière de risques professionnels, de prestations familiales, d’assurance vieillesse et de soins de santé dans les conditions définies par la loi » (1998 :12). Selon les termes de cette loi, la protection sociale couvre trois grandes dimensions : la prise en charge des soins de santé relatifs aux risques professionnels survenus, la prestation familiale et la maternité et l’assurance vieillesse. C’est ainsi que le gouvernement donne la priorité à la mise en œuvre de l’assurance maladie sociale pour les fonctionnaires et/ou les autres travailleurs du secteur formel parce qu’ils seraient plus faciles à identifier et à inscrire. En ce qui concerne la couverture médicale pour les plus pauvres et vulnérables, diverses stratégies ont été expérimentées et mises en œuvre à différentes échelles : exemption de paiement pour des groupes ou pathologies spécifiques, différenciation des prix et subventions ciblées pour les activités qui produisent un niveau élevé d’externalités (vaccination, traitement des maladies infectieuses…).
A côté de ce système étatique, il y a les mutuelles sociales qui sont des groupements qui, essentiellement au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droits, une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité visant la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences. Elles souffrent d’insuffisances fonctionnelles, organisationnelles qui constituent des limites à leurs rôles sociaux. En 2005, le ministère de la santé avait identifié 25 mutuelles du secteur formel qui comptaient 41 800 bénéficiaires. En milieu rural et urbain, on dénombrait à la même année, 119 mutuelles de l’économie informelle dont le nombre de bénéficiaire était de 18.900. Les plus représentatifs sont : la Société Burkinabé d’Assistance Secours (SOBAS), la Compagnie d’Assistance et de Secours d’Urgence du Burkina (CASUB), la Mutuelle Burkinabé d’Assistance Sociale et de Solidarité (MUBASS), la Nationale d’Entraide et de Solidarité Africaine (NESSA) (Yoni, 2000), la Mutuelle National de Santé des Étudiants du Burkina Faso (MUNASEB)
Conscient des insuffisances et des limites de l’action publique en matière de sécurité sociale, une politique nationale de sécurité et de santé au travail a été adoptée pour prendre en compte les autres catégories sociales à travers la loi N°15-2006/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs et assimilés au Burkina Faso. Elle vise à étendre la protection sociale à la majorité de la population, en élargissant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, des professions libérales et de l’économie informelle par la souscription d’une assurance volontaire auprès de la CNSS.
Enfin, les programmes d’aide sociale sont des initiatives pour la protection des groupes vulnérables à travers des campagnes de sensibilisation, des services d’aides aux handicapés, aux réfugiés et sinistrés, aux enfants en situation particulièrement difficiles, aux exclus sociaux. Les services offerts par le marché des assurances sont inaccessibles aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs du monde rural.
De ce fait l’accès aux services de santé est encore largement assuré par le paiement direct des ménages (31,4 % en 2016 alors que l’on vise un plafond de 20%2 pour limiter les dépenses catastrophiques en santé des ménages). En outre la qualité des services de santé[1] est en dessous des besoins et que l’accès aux soins de qualité reste inéquitable. Dans ce contexte, la couverture sanitaire universelle s’avère nécessaire pour garantir l’accès à des soins de qualité à toute la population en général et aux indigents en particulier y compris en garantissant la protection financière contre le risque maladie.
Le gouvernement du Burkina Faso a pris des initiatives pour progresser vers la couverture sanitaire universelle. Cela s’illustre d’abord par l’adoption de la loi RAMU et la mise en place de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU). La couverture sanitaire universelle (CSU) est définie comme une approche globale permettant à l’ensemble de la population d’avoir un accès, sans discrimination, à des services de base qui regroupent la promotion de la santé, la prévention des maladies, le traitement et de la réadaptation, l’accessibilité à des médicaments de base, sûrs, abordables, efficaces et de qualité ((OMS 2010).[2] ). Rappelons que selon l’article 48 de la loi n 060-2015 du 5 septembre 2015 portant régime d’assurance maladie universelle, l’Etat est financièrement responsable de la couverture des personnes indigentes. Il était prévu que cette cible soit couverte gratuitement dès décembre 2019.
Dans le processus de transition vers la CSU, les auteurs identifient trois profils étatiques : le modèle étatiste ; le modèle du marché et d’assurance et enfin le modèle subsidiariste (Op.cit, 2012). Trois composantes forment le trépied de la CSU : la couverture de la population en services de santé ; l’élargissement de paquets de services offerts et la protection financière.
Les trois directions du « cube » (Durairaj, Evans, 2011, p. 6) dans lesquelles il faut progresser en vue d’atteindre la couverture universelle : la proportion de population bénéficiant d’une couverture santé, la gamme de prestations et services essentiels proposés en fonction des besoins, et enfin la proportion des coûts qui seront couverts (OMS, 2008). Dans l’idéal, c’est « l’ensemble de la population » qui devrait être en mesure de recevoir les soins de qualité dont elle a besoin à un coût qui ne l’appauvrit pas (Ngabire, 2013). Dans cette perspective, la CSU est d’abord et avant tout un contrat social (OMS, 2018, p.15[3]).
C’est pour cette raison, qu’il semble opportun d’actualiser l’information sur les goulots d’étranglement et insuffisances constatés dans la progression du BF vers la couverture santé universelle (CSU).
2.2. Objectifs de l’étude
2.1.1. Objectif général
L’objectif de cette étude est d’analyser les goulots d’étranglement du processus de mise en œuvre efficace de la CSU selon les dimensions de l’accès aux services, de la qualité des services, les coûts des services et le cadre institutionnel et politique.
2.1.2. Objectifs spécifiques de l’étude
De façon spécifique, il s’agira dans le cadre de cette étude de :
- Faire un diagnostic des actions et cadres mis en place pour l’atteinte de la CSU au Burkina Faso,
- Evaluer le niveau de progression du Burkina Faso en matière de réalisation de la CSU,
- Identifier les domaines de blocage (financement, planification & priorisation, engagement politique, etc.) leurs causes et conséquences au développement de la stratégie de la Couverture santé universelle au Burkina ;
- Identifier des possibilités d’engagements de la société civile et des communautés pour contribuer à accélérer l’atteinte de la CSU.
- Proposer des leviers sur lesquels ou stratégies à actionner pour l’accélération du Burkina vers la CSU.
III. Méthodologie préconisée
Dans le cadre du Projet « Création d’un mouvement social en faveur de la CSU au Burkina Faso », cette étude vise à produire des évidences pour alimenter la communication et la conscientisation des acteurs engagés pour la CSU. De ce fait, il est attendu une adhésion des acteurs aux résultats du projet et aux conclusions des études menées.
En marge donc d’une exploitation documentaire bien nourrie, l’étude devra passer par un diagnostic approfondi du système de santé et des politiques de santé mises en œuvre jusque-là. Ce diagnostic devra garantir les avis des acteurs stratégiques du système de santé ainsi que des partenaires au développement qui soutiennent la transition vers la CSU.
Le consultant devra donc prioriser une approche participative afin d’anticiper sur l’adhésion des acteurs aux résultats, et surtout leur engagement au soutien au mouvement social vers la CSU.
3.1. Production du rapport et valorisation des résultats de l’étude
Au terme de l’étude, un rapport final provisoire sera produit sous la coordination de l’investigateur principal. Ce rapport fera l’objet d’une restitution auprès des différents partenaires qui y apporteront les amendements nécessaires pour sa finalisation pour aboutir à un rapport final définitif.
Les résultats de cette étude seront exploités dans une campagne d’information, de conscientisation et d’engagement des acteurs tout azimut vers la CSU.
3.2. Dispositions éthiques
L’étude sera réalisée avec une autorisation des autorités sanitaires (autorisation du secrétaire général du ministère).
Nous veillerons à la confidentialité (par l’anonymat des interviews) et garantirons le consentement éclairé pour la collecte et l’utilisation des renseignements. Une fiche d’information et de consentement sera élaborée et utilisée avant chaque interview. Le consentement éclairé écrit sera requis pour tous les participants et signé en deux (02) exemplaires par participant (une copie retenue par l’équipe de recherche, une copie retenue par le participant). Les empreintes digitales seront sollicitées pour les participants analphabètes.
Les transcriptions n’incluront pas les informations d’identification sensibles.
Les renseignements ou informations collectées ne seront utilisées que conformément aux objectifs de la présente recherche évaluative.
IV. Chronogramme d’exécution
Ceci est un chronogramme indicatif de l’étude. Il fera l’objet d’ajustement et de finalisation par le consultant.
| N° | Livrables | Date limite de soumission |
| Préparation : développement de protocoles et d’outils | ||
| N°1 | · Protocole, outils, formulaires finalisés, prêts à être soumis au comité Ethique de Recherche en Santé
· Mise en place d’un comité de suivi |
___/ Septembre 2020 |
| Recrutement et formation des agents de collecte et des superviseurs | ||
|
N°2 |
· Recrutement des enquêteurs et superviseurs de l’étude
· Formation des enquêteurs et superviseurs · Plan de pré-test · Rapport sur la formation des enquêteurs et des superviseurs · Rapport du pré-test des outils d’étude |
___/ Septembre 2020 |
| Collecte | ||
| N°3 | · Collecte des données
· Rapport d’étape n°1 résumant les activités de collecte des données, les défis et les solutions et les prochaines étapes |
___/ Septembre 2020 |
| Analyse et gestion des données | ||
| N°4 | · Encodage des données
· Transcription des données · Rapport d’étape n°2 résumant les activités de retranscription des données collectées, les défis, les solutions et les prochaines étapes · Analyse préliminaire des données |
___/ Septembre 2020 |
| Rapports | ||
| N°5 | · Rapport préliminaire de l’étude | ___/ Septembre 2020 |
| N°6 | · Atelier de validation du rapport préliminaire | ___/ Août 2020 |
| N°7 | · Rapport final
· Transmission de toutes les archives des notes/ journaux de terrain, transcriptions d’interviews, enregistrement audio |
___/ Août 2020 |
V. Profil/qualification et expériences requises
Pour cet appui l’expert, communautaire doit :
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire en médecine, ou d’un diplôme de (Bac + 5 ans) en santé publique, en science sociale ou dans un domaine apparenté ;
- Avoir une bonne connaissance du système national de santé, des politiques et protocoles des priorités de planifications et des défis en matière de santé publique ;
- Avoir une bonne connaissance de la couverture santé universelle ;
- Avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans dans les conduites d’études qualitatives et au moins trois (03) ans dans l’analyse des thématiques sur la santé, CSU ou les ODD ;
- Avoir une bonne maitrise en matière d’analyse des documents ;
- Avoir une bonne maitrise du système de santé au Burkina Faso.
Il devra en plus avoir :
- Une excellente capacité d’analyse et de rédaction ;
- Une grande capacité de travail en équipe et une aptitude à établir des relations de travail efficaces avec les acteurs du monde communautaire, du secteur privé, du secteur public et des partenaires techniques et financiers ;
- Une très bonne capacité à interagir et à communiquer oralement et par écrit ;
- Une bonne maitrise des outils d’analyse qualitative comme N-Vivo ou autres.
VI. Durée et conditions générales de la mission
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique du RAME durant toute la durée de la mission.
Le consultant sera engagé pour 15 jours de travail effectif. La durée globale de la mission ne pourra pas excéder 30 jours.
VII. Déroulement du recrutement
Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature complets déposés dans les délais. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.
Les candidats retenus à cette phase de présélection subiront un entretien oral dans les locaux du RAME pour le recrutement définitif du consultant.
VIII. Méthodologie et période de candidature
Toutes personnes intéressées répondants aux critères définis ci-dessus peuvent postuler à cette offre en déposant une demande contenante :
- Un curriculum vitae détaillé et signé ;
- Une copie légalisée de son diplôme ;
- Une proposition technique de la compréhension des TDR et une revue opérationnelle de la méthodologie de l’étude, un chronogramme détaillé ;
- Une proposition financière.
Les dossiers de candidatures peuvent être reçus :
- Au Secrétariat du RAME aux jours et heures ouvrables (lundi à vendredi de 7h30mn à 16h 30 mn
- Par mail à secretariat@rame-int.org avec copie à crip@rame-int.org.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au Vendredi 11 septembre 2020. Aucun dossier ne pourra être reçu après cette date.
Pour toutes autres informations veuillez contacter le secrétariat du RAME au 25 33 41 16.
NB : Le RAME se réserve le droit de ne donner suite à tout ou une partie du présent appel à candidature.
—————————————————————————————————————————————–
[1] infrastructures/équipements/logistiques, ressources humaines, prestations de services, produits de santé,
[2] WHO (2010), Health financing: the path to universal coverage, World Health Report 2010.
[3]Organisation mondiale de la Santé et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/ La Banque mondiale; Des systèmes sains pour une couverture santé universelle – une vision commune pour des vies saines [Healthy systems for universal health coverage – a joint vision for healthy lives]. Genève : 2018.
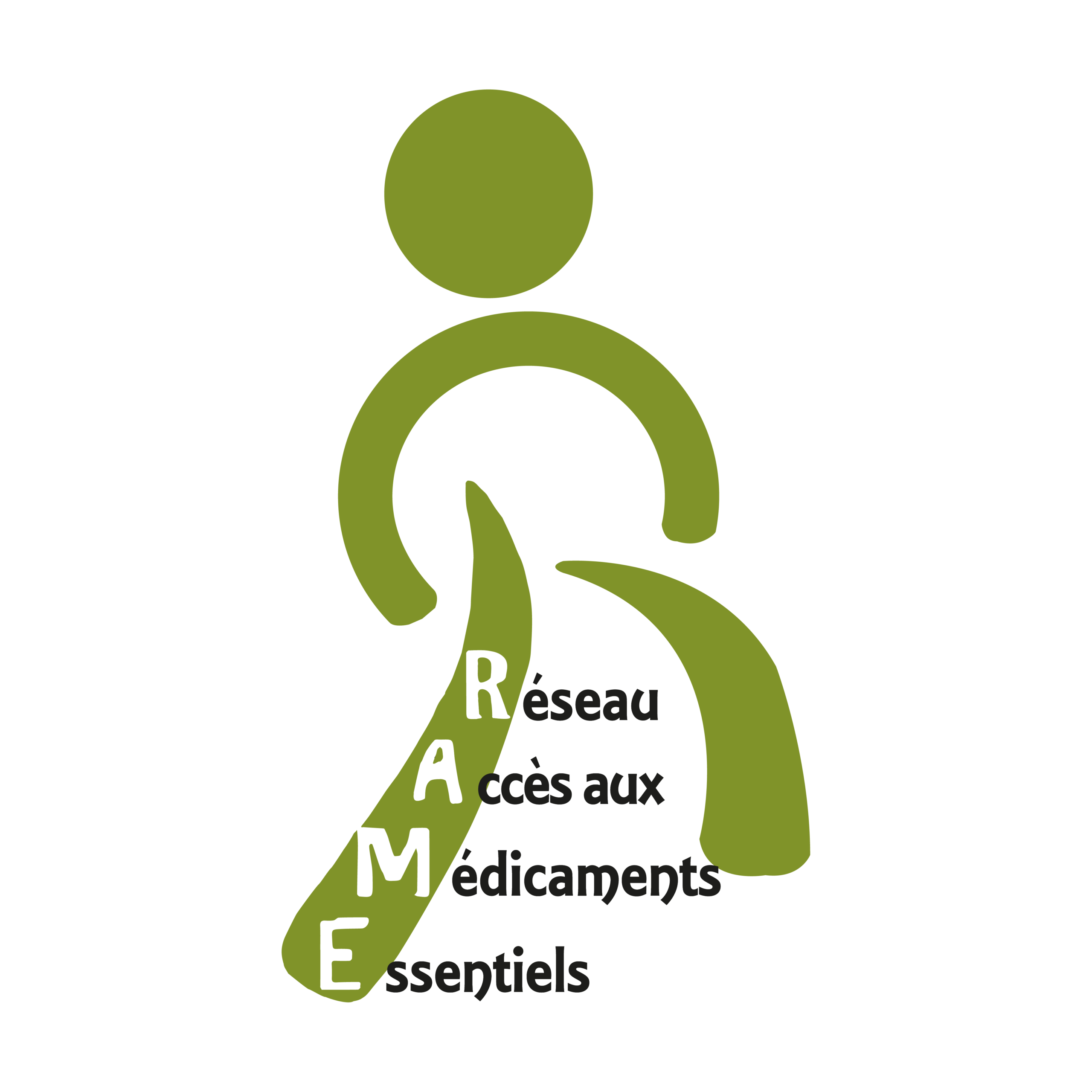
No responses yet